Accueil > L’œuvre de Philippe Ariès > Documents : articles et contributions > P. Ariès, "L’enfant et la rue, de la ville à l’antiville", 1979
P. Ariès, "L’enfant et la rue, de la ville à l’antiville", 1979
mercredi 30 décembre 2015, par
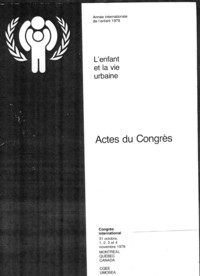
– « L’enfant et la rue, de la ville à l’antiville » est à l’origine une communication intitulée « L’environnement urbain : l’enfant hors de la famille dans la cité », publiée, en 1979, dans L’enfant et la vie urbaine. Congrès international, (Montréal, Conseil du Québec de l’enfance exceptionnelle, p. 45-55). Il a été repris ensuite dans une version légèrement modifiée intégrant les intertitres dans la revue Urbi, II, 1979, p. III-XIV puis dans Essais de Mémoire 1943-1983 (Seuil, 1993).
Extraits de l’article de Philippe Ariès
« Dans le passé, l’enfant appartenait tout naturellement à l’espace urbain, avec ou sans ses parents. Dans un monde de petits métiers, et de petites aventures, il était une figure familière de la rue. Pas de rue sans enfants de tous âges et de toutes conditions. Ensuite, un long mouvement de privatisation l’a retiré peu à peu de l’espace urbain, qui cessait dès lors d’être un espace de vie épaisse, où le privé et le public ne se distinguaient pas, pour devenir un lieu de passage, réglé par les logiques transparentes de la circulation et de la sécurité. Certes, l’enfant n’a pas été le seul exclu de cette grande oeuvre de mise en ordre, de mise au pas : tout un monde bigarré a disparu avec lui dans la rue. Mais sa solidarité de fait avec ce monde-là est significative. Le fait important est donc double : d’abord nettoyer la rue d’un petit peuple indocile, qui avait été longtemps accepté, de plus ou moins bon gré, mais sans la volonté de l’en ôter, et qui est plus tard devenu suspect, inquiétant et condamné. Ensuite, dans le même temps, séparer l’enfant de ces adultes dangereux, en le retirant de la rue. La rue est immorale tant qu’elle est un séjour. Elle n’échappe à l’immoralité qu’en devenant un passage, et en perdant dans l’urbanisme des années trente-cinquante les caractères et les tentations du séjour.
Les cris de la rue
Elle a bien existé, cette ville où les enfants vivaient et circulaient, les uns hors de leurs familles, les autres sans. Cette ville, les organisateurs, les hommes de l’ordre et de la sécurité, l’ont longtemps regardée avec inquiétude, comme une source de dangers, de pollution physique et morale, de contagion et de délinquance. Quelques-uns, au contraire, la découvrent aujourd’hui avec tendresse et nostalgie. Cette ville, nous l’avons perdue ; quand et pourquoi ? Ce qui l’a remplacée n’est pas une autre ville, c’est la non-ville, l’antiville, la ville intégralement privatisée. Elle a même perdu son nom de ville. En mai 1977, vous entendez bien : en 1977, presque aujourd’hui, un préfet français intervenait dans une discussion sur les autoroutes périphériques de la région parisienne. Son propos est ainsi rapporté par un Bulletin officiel : « Au sujet des rocades, le préfet a expliqué sa conception de l’urbanisation. Il a insisté sur l’opportunité d’abandonner le terme de "villes", qui suppose des murailles, des limites, au profit du terme d"’agglomérations", reliées entre elles par des voies rapides. » Le fonctionnaire parisien pensait sans doute aux merveilleuses métropoles américaines, objets de son admiration et de son envie.
Qu’est devenu l’enfant dans ce passage de la ville à l’agglomération, mais aussi, outre l’enfant, celui qui lui est étroitement solidaire, l’adulte ? De la ville hellénistique, Alexandrie ou Rome, à la ville médiévale, chrétienne ou musulmane, ou à la médina méditerranéenne d’aujourd’hui, l’image de l’enfant dans la rue n’a guère changé. La rue l’attirait, il aimait son spectacle, suspect aux parents comme aux instituteurs et aux pouvoirs. Le poète grec Hérondas met en scène une mère qui se plaint au maître d’école de l’inconduite de son fils : le gamin fait l’école buissonnière, traîne dans la rue où il fréquente les flâneurs et joue avec eux : ses « noix » d’enfant (l’équivalent de nos billes) ne lui suffisent pas. Il partage les divertissements immoraux des adultes, il joue aux dés (peut-être pour de l’argent). Ses dés sont aussi usés que ceux des vieux amateurs, et sa mère constate avec indignation qu’ils luisent plus que les fonds de ses
casseroles. La bonne correction qu’il recevra de son maître ne l’empêchera pas de retourner avec ses dés aux rencontres douteuses des rues et des carrefours. Les dessins de damiers ou de jeux de marelle qu’on a trouvés à Rome sur le forum étaient peut-être tracés par les enfants d’écoles voisines, situées tout près sous les portiques, à même la rue. Ceux-ci y rencontraient les petits apprentis qui circulaient dans la ville pour leur devoir ou leur plaisir. Les enfants avaient aussi leur place, celle-ci autorisée, dans les cérémonies publiques qui avaient lieu dehors, dans la rue ou sur les places. Ils accompagnaient leurs parents aux distributions d’aumônes : des sculptures nous les montrent, juchés sur l’épaule de leurs pères.
[...]
Le philanthrope effarouché
A partir du XVIIIe siècle, la rue, le cabaret furent considérés comme des endroits dangereux qu’il va falloir assainir. Dans ce but on emploie la force, la police, mais aussi d’autres moyens plus doux, et sans doute plus efficaces. Sous l’influence plus ou moins indirecte de Michel Foucault, des jeunes chercheurs français, parmi lesquels Arlette Farge, que nous venons de citer, se sont attachés à montrer comment les pauvres qui constituaient une sorte de subculture ont été convertis aux genres de vie familiaux des bourgeoisies par l’action des philanthropes, des moralistes de l’Eglise relayés ensuite, de nos jours, par les travailleurs sociaux et les psychologues. L’histoire de cette acculturation est maintenant bien connue dans ses grandes lignes : l’enfant a été retiré de la rue et enfermé dans un espace désurbanisé, à la maison ou à l’école, rendues l’une et l’autre imperméables aux rumeurs du dehors. Quel formidable changement pour ces enfants et ces jeunes gens, habitués à la liberté, voire aux licences de la rue, et désormais, dans leurs travaux comme dans leurs jeux, éloignés des activités productives, privés de responsabilité, soumis aux disciplines éducatives ! Ainsi toute une partie de la population, jeune mais jadis active, va être déplacée du dehors vers le dedans, d’une vie totale, à la fois privée, professionnelle et publique, vers le monde clos de la privacy.
La physionomie de la rue a été nécessairement affectée par ce mouvement de vidage et par le conditionnement de ce qui restait. On aurait pu croire que la sociabilité globale de la rue allait disparaître. C’est se tromper d’environ un siècle, et il est très remarquable que la privatisation de la vie familiale, l’industrialisation et l’urbanisation du XIXe siècle ne sont pas parvenues à étouffer les formes spontanées de la sociabilité urbaine, même si, dans certains cas, celle-ci s’est exprimée autrement. C’est seulement au milieu du XXe siècle, donc bien après l’industrialisation, que l’effondrement s’est produit, et en même temps celui de la ville. « La rue, dit Arlette Farge dans son commentaire, est perçue par les petits personnages comme un monde prestigieux, recelant une vie intense assez semblable à une fête. »
[...]
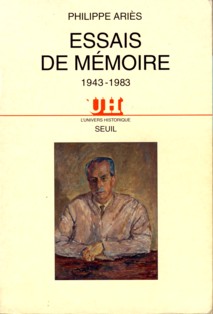
Le petit délinquant
L’école primaire était, à la fin du XIXe siècle, très généralement fréquentée en France. C’est donc à la fois autour de l’école et du quartier (une école par quartier) que s’organisa alors, et au début du XXe siècle, la sociabilité de l’enfance populaire. C’est l’école qui fait la différence avec la période précédente du XVIIIe et du début du XIXe siècle — celle décrite par Arlette Farge. L’enfant est désormais l’écolier, reconnaissable au tablier noir qu’il ne quittait guère et qui le désignait comme un uniforme. Mais l’école ne l’enlevait à la rue qu’une partie de la journée et de la semaine. Ni parent ni bonne ne venaient le chercher ou le ramener : il était libre de son temps et il le passait dehors, en groupe, avec ses camarades. Même le petit-bourgeois rêvait d’échapper à ses anges gardiens pour se mêler aux petits gars de la communale (l’école des pauvres !) et vivre, dans la rue, des aventures aussi intenses. C’est ce que dit en 1929 Jean Cocteau des enfants de la rue d’Amsterdam. Cette rue « est leur place de Grève, une sorte de place du Moyen Age, de cour d’amour, de jeux de miracles, de bourse aux timbres [divertissement plutôt bourgeois] et aux billes [celui-ci, universel], de coupe-gorge où le tribunal juge les coupables et les exécute, où se complotent de longue main ces brimades qui aboutissent en classe [je souligne], et dont les préparatifs étonnent les professeurs ». En 1912, vers la même époque que celle évoquée par Cocteau, Pergaud racontait quelles sortes de conflits et de brimades occupaient les bandes d’enfants, après l’école. Dans son livre La Guerre des boutons, comme dans Les Enfants terribles de Cocteau, à la campagne comme à la ville, les inventions de ces petites bandes apparaissent comme « signes de la vitalité des enfants » (Marie-José Chombart de Lauwe). Elles ne sont plus dénoncées : c’est peut-être qu’elles deviennent plus rares et qu’on se demande si elles n’appartiennent pas à un passé qui s’éloigne et devient nostalgique.
[...]
Un rêve de pierres
Chose curieuse, on retrouve dans le Paris contemporain de Philippe Meyer beaucoup de traits du Paris du XVIIIe siècle d’Arlette Farge, et en particulier l’irrigation des maisons par la rue. Des espaces existent, qui sont communs à la rue et à la maison, dédales d’impasses, de passages, de cités, de ruelles. Meyer insiste sur les « places », mi-privées, mi-publiques. Elles forment « une sorte de village (avec ses commerçants) qui tient plus des courées du XIXe siècle [et des "quarrés" qu’Arlette Farge a trouvés dans les documents du XVIIIe siècle parisien] que de l’urbanisation qui l’entoure ». La vie dans les réseaux de micro-espaces a été préservée parce que l’automobile hésitait à s’y engager, sauf celle des habitants : « Cette faible circulation fait que les enfants peuvent jouer au ballon sur la chaussée, s’y tenir rassemblés ou s’y ébattre librement à portée du regard des mères qui peuvent les interpeller des fenêtres de leurs cuisines. » Mais la « place » n’est pas un espace réservé aux seuls enfants. On y retrouve le mélange des âges caractéristique de la ville ancienne. « La place centrale est un lieu de rencontre et d’échange [je souligne], un centre où circulent toutes sortes d’informations, un poste duquel on peut observer tous les détails de la vie de l’îlot. » Il en résulte une coopération entre les différents groupes d’âges, « tout en gardant les distances qu’il convient ». Ainsi existe-t-il des relations entre les bandes d’enfants et les bande de jeunes.
[...]
Gavroche retrouvé ?
Cette ville d’utopie n’a pas été réalisée (sinon à Los Angeles), et les agglomérations d’aujourd’hui ont été conçues comme des compromis entre les rêves de demain et les contraintes du passé. Pour les enfants, on pensait d’abord qu’on avait assez fait en assurant à l’intimité familiale les bonnes conditions de son fonctionnement et de sa sécurité. La privacy de la famille comptait plus que celle de chacun de ses membres. Plus de petits recoins abandonnés aux enfants, dans cet univers fonctionnel où chaque chose était prévue, où chaque place avait sa destination. Hors de la maison, on avait cependant consenti, non sans réticence, quelques espaces réservés aux jeux, aux loisirs des enfants, si vraiment la maison, l’école et ses activités multiples ne leur suffisaient pas ! Les moralistes s’indignèrent que ces espaces fussent ou désertés ou dévastés. Hors de la maison et des espaces imposés, plus de rues pour accueillir les enfants. Il leur fallut alors découvrir, dans ce monde trop quadrillé, quelques lacunes pour s’y installer, comme jadis dans la rue : les parkings souterrains, les cages d’escalier, les rares coins oubliés ou abandonnés, quand ce n’étaient pas les caves dont ils avaient fracturé les portes.
Les historiens de l’art ont été, me semble-t-il, les premiers, avant les médecins, les sociologues, les psychologues, les prêtres, éblouis par les mirages de la modernité, à s’inquiéter de cette dévaluation de la rue, à protester contre sa destruction, à défendre ses fonctions, et d’abord ses fonctions esthétiques. »
[...]
Consulter aussi en ligne sur un thème proche : Philippe Ariès : "Du Sérieux frivole"
 site dédié à Philippe Ariès
site dédié à Philippe Ariès